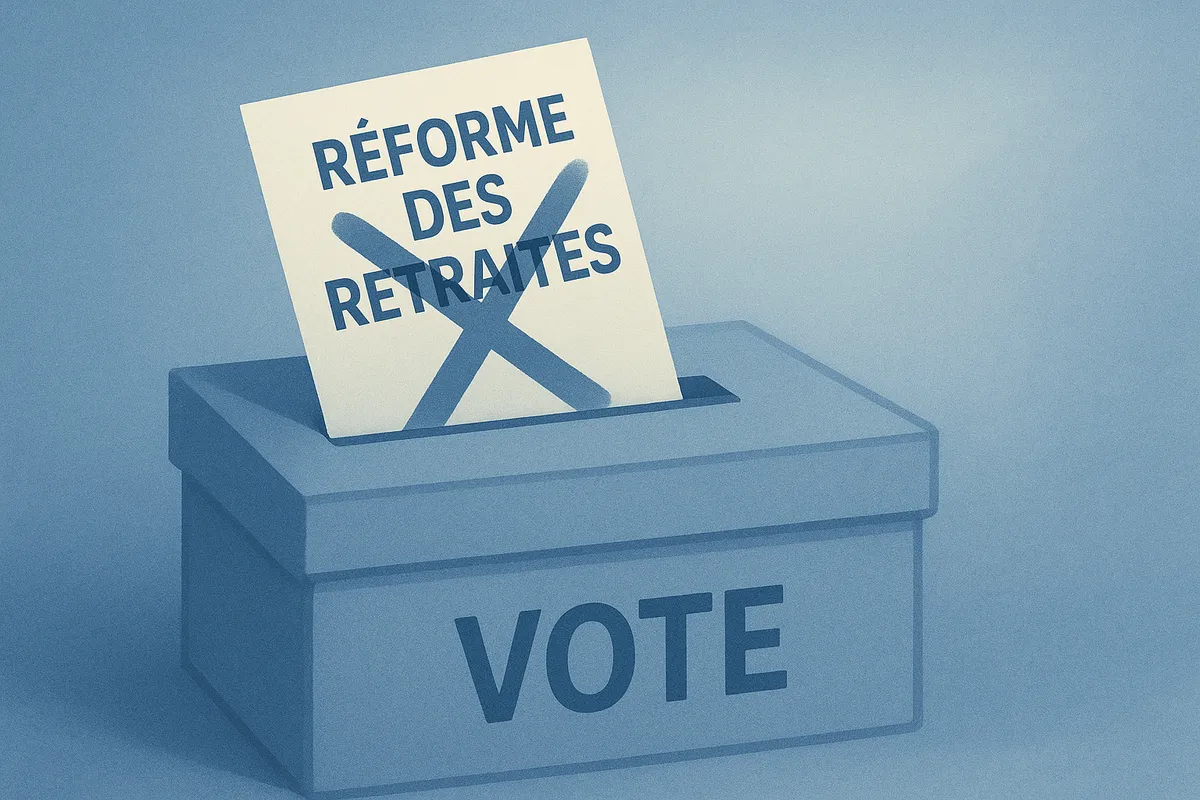Note souveraine : pourquoi la France chute
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées sont à titre informatif uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le 17 octobre 2025, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note souveraine de la France de AA- à A+. Cette décision, qui fait suite à une première dégradation en mai 2024, place désormais la France au même niveau que l'Espagne ou le Portugal. Si cette actualité a fait réagir les marchés financiers, elle interroge aussi directement les épargnants français : que signifie réellement cette dégradation, et quelles en sont les conséquences sur leur patrimoine ?
Qu'est-ce qu'une note souveraine ?
Avant de comprendre l'impact de ce déclassement, il est essentiel de saisir ce qu'est une note souveraine. Il s'agit d'une évaluation de la capacité d'un État à rembourser sa dette publique. Cette note est attribuée par des agences de notation indépendantes, dont les trois principales sont Standard & Poor's (S&P), Fitch et Moody's.
Ces agences analysent la situation économique, budgétaire et politique d'un pays pour déterminer le risque qu'il représente pour les investisseurs. Plus la note est élevée, plus l'État est considéré comme fiable. À l'inverse, une note dégradée signale une augmentation du risque de défaut de paiement.
L'échelle de notation la plus couramment utilisée va de AAA (note maximale) à D (défaut de paiement). Entre ces deux extrêmes, on trouve une série de notes intermédiaires : AA+, AA, AA-, A+, A, A-, et ainsi de suite. Chaque cran compte : une dégradation, même d'un seul niveau, peut avoir des répercussions significatives sur les coûts d'emprunt d'un État et, par ricochet, sur l'économie nationale.
Pourquoi ces notes sont-elles si importantes ? Parce qu'elles influencent directement les taux d'intérêt que l'État doit payer pour emprunter sur les marchés financiers. Une note dégradée signifie généralement des taux plus élevés, ce qui alourdit la charge de la dette et peut limiter les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement.
La dégradation de la France : une érosion progressive
La France n'en est pas à sa première dégradation. L'histoire récente montre une érosion progressive de la confiance des agences de notation. En janvier 2012, dans le contexte de la crise de la zone euro, la France a perdu pour la première fois son triple A, cette note d'excellence qu'elle détenait depuis 1975. À l'époque, Standard & Poor's avait abaissé la notation à AA+, quelques mois avant l'élection présidentielle.
Depuis, la descente s'est poursuivie par paliers. En novembre 2013, S&P a de nouveau dégradé la France, passant de AA+ à AA. Les années suivantes ont vu d'autres ajustements : Fitch a retiré le triple A en juillet 2013, tandis que Moody's suivait le mouvement en 2015.
Plus récemment, le rythme s'est accéléré. En avril 2023, Fitch a abaissé la note française à AA-. L'année 2024 a marqué un tournant avec une nouvelle dégradation par S&P en mai, suivie par Moody's en décembre. Puis, en septembre 2025, Fitch est passé de AA- à A+, avant que S&P ne s'aligne quelques semaines plus tard, le 17 octobre.
Cette chronologie révèle une tendance préoccupante : en à peine treize ans, la France est passée de AAA à A+, perdant ainsi quatre crans dans l'échelle de notation. Les raisons invoquées par les agences convergent : incertitude budgétaire persistante, dette publique en constante augmentation, et instabilité politique. S&P a même qualifié la situation actuelle de "crise politique la plus grave depuis la fondation de la Ve République en 1958".
L'agence prévoit désormais que la dette publique brute atteindra 121% du PIB en 2028, contre 113% fin 2024. Cette trajectoire inquiète d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte de déficit budgétaire élevé et de difficultés à mettre en œuvre des réformes structurelles.
Voici l'évolution de la note française depuis la perte du triple A :
Note : L'échelle numérique utilisée dans ce graphique convertit les notes en valeurs (AAA=21, AA+=20, AA=19, AA-=18, A+=17, etc.) pour faciliter la visualisation de la tendance.
Où se situe la France aujourd'hui ?
Maintenant que la France est notée A+ par S&P et Fitch, comment se positionne-t-elle par rapport à ses voisins européens ? La comparaison est instructive et révèle un paradoxe : alors que la France descend, certains pays remontent.
Dans la zone euro, seuls quelques États conservent encore le précieux triple A : l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Hors zone euro, le Danemark et la Suède maintiennent également cette note d'excellence. L'Allemagne reste ainsi la principale économie européenne à conserver la confiance maximale des agences de notation.
Au niveau A+, la France se retrouve désormais au même rang que l'Espagne, le Portugal, la Chine ou encore le Japon. Ce rapprochement avec l'Espagne est particulièrement symbolique : alors que la France dégringole, l'Espagne progresse. En 2025, les agences Moody's et Fitch ont même relevé la note espagnole, saluant "l'excellente performance de croissance de l'économie espagnole, grâce à un modèle de croissance plus équilibré, à des améliorations du marché du travail et au renforcement du secteur bancaire".
Le tableau ci-dessous présente les notes souveraines des principales économies européennes selon S&P :
| Pays | Note S&P (2025) | Tendance récente |
|---|---|---|
| Allemagne | AAA | Stable |
| Pays-Bas | AAA | Stable |
| Luxembourg | AAA | Stable |
| France | A+ | ↓ Dégradée (octobre 2025) |
| Espagne | A+ | ↑ Relevée (septembre 2025) |
| Portugal | A+ | Stable |
| Italie | BBB+ | ↑ Relevée (avril 2025) |
Ce classement montre que la France, bien qu'elle reste loin de la zone à risque (notée BBB ou moins), a perdu son statut de référence en Europe. La dynamique est d'autant plus préoccupante que les taux d'emprunt français à dix ans ont même temporairement dépassé ceux de l'Italie en septembre 2025, une première historique.
Quelles conséquences concrètes pour les épargnants ?
Au-delà des considérations macroéconomiques, cette dégradation a des répercussions tangibles pour les épargnants français. Comprendre ces impacts permet d'ajuster son allocation d'actifs en conséquence.
Le premier effet concerne les taux d'intérêt. Lorsqu'une note souveraine est abaissée, les investisseurs exigent généralement des taux plus élevés pour compenser le risque accru. Si l'État doit emprunter plus cher, cette hausse peut se répercuter sur l'ensemble du système financier. Les banques, qui s'appuient sur les taux souverains comme référence, peuvent à leur tour augmenter les taux qu'elles appliquent aux particuliers. Concrètement, cela signifie que les crédits immobiliers, déjà sous pression, pourraient cesser de baisser, voire repartir à la hausse.
Au-delà des taux, c'est la question de la fiscalité qui inquiète. Face à une dette publique en constante augmentation et une capacité budgétaire restreinte, le risque d'une taxation accrue de l'épargne et du patrimoine devient plus tangible. Les épargnants peuvent légitimement craindre de nouvelles mesures fiscales visant leurs placements, qu'il s'agisse de l'assurance-vie, des livrets réglementés ou de l'immobilier.
Pour les détenteurs d'obligations françaises, la dégradation constitue également un signal d'alerte. Même si la France demeure éloignée d'un défaut de paiement, la valeur des obligations d'État peut fluctuer en fonction de la perception du risque par les marchés. Une nouvelle dégradation pourrait entraîner une baisse de la valeur de ces titres, affectant ainsi les portefeuilles qui y sont exposés.
L'immobilier domestique n'est pas épargné. Une dégradation de la note souveraine reflète souvent des difficultés économiques plus larges qui peuvent peser sur le marché immobilier. Conjuguée à des taux de crédit potentiellement plus élevés, cette situation peut ralentir la dynamique du marché et affecter la valorisation des biens.
Face à ces risques, plusieurs stratégies s'imposent. La diversification géographique devient essentielle : ne pas concentrer l'intégralité de son épargne sur des actifs français permet de se prémunir contre un risque souverain localisé. De même, la diversification sectorielle – en combinant immobilier, actions, obligations, et placements monétaires – offre une meilleure résilience face aux chocs.
Enfin, maintenir une part de liquidités et privilégier des placements sécurisés à court terme peut s'avérer judicieux dans un contexte d'incertitude. L'objectif est de préserver une flexibilité suffisante pour s'adapter rapidement si la situation venait à se dégrader davantage.
Une vigilance nécessaire
La dégradation de la note souveraine française de AA- à A+ n'est pas un événement anodin. Elle s'inscrit dans une tendance de long terme qui reflète des fragilités structurelles de l'économie française : dette publique élevée, déficit budgétaire persistant, et instabilité politique.
Pour les épargnants, cette situation impose une vigilance accrue. Si la France reste aujourd'hui loin d'une crise de la dette, les signaux envoyés par les agences de notation doivent inciter à adapter sa stratégie patrimoniale. Diversifier ses placements, tant géographiquement que sectoriellement, et maintenir une certaine flexibilité apparaissent comme des principes de prudence essentiels.
La suite dépendra largement de la capacité de la France à stabiliser ses finances publiques et à restaurer la confiance des marchés. En attendant, les épargnants ont tout intérêt à suivre de près l'évolution de cette situation et à anticiper les ajustements nécessaires pour protéger leur patrimoine.
Sources :
- Franceinfo - Visualisez comment la note française s'est progressivement dégradée
- Public Sénat - Quelles conséquences pour la France ?
- Touteleurope.eu - Dette publique : quels sont les pays européens les mieux notés ?
- Zonebourse - S&P s'attend à ce que la dette publique de la France atteigne 121% du PIB en 2028